11/07/2015
OLYMPE DE GOUGES :Son proçès sous la Terreur
REDIFFUSION ( 1ere du 6 octobre 2006)
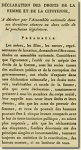 La femme a le droit de monter sur l’échafaud ;
La femme a le droit de monter sur l’échafaud ;
Elle doit avoir également celui de monter à la Tribune.
Palais littéraire du 14 septembre 2005
Heidi RANCON CAVENEL
La femme a le droit de monter sur l'échafaud
cliquer pour imprimer avec les liens.doc
lire les documents hsitoriques de la BNF in fine
Plaidoyer d’Olympe de Gouges,
rédigé avant sa comparution devant le Tribunal révolutionnaire
Trop belle, trop courageuse, trop entière pour son siècle, Olympe de Gouges (cliquer pour lire)sera guillotinée le 3 novembre 1793. D’abord écrivain, elle fréquente assidûment les salons littéraires ; c’est à l’âge de quarante ans qu’elle se tourne vers la politique. Très impliquée, elle refuse que la révolution se fasse sans les femmes, pour lesquelles elle réclame l’égalité des droits. Ainsi, elle écrira en 1791, sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
.
Mais ses engagements vont encore plus loin. Elle s’insurge contre l’esclavage, s’oppose à la peine de mort, prône la non-violence, défend les orphelins et les droits des mères célibataires. Elle est l’une des premières à faire des propositions concrètes en faveur de la démocratie.
Rejetée des sphères intellectuelles et du milieu politique, elle est portée à l’échafaud pendant les sombres heures de la Terreur. Ses derniers mots seront : Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort !
.
PROCÈS DE MARIE-OLYMPE DE GOUGES
DEVANT LE TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE
ii – documents du procès
(communiqués par m. rené viénet)
1° acte d’accusation signé par Fouquier Tainvile cliquez
(accéder au fichier pdf)
2° plaidoyer de m-o de gouges rédigé avant sa comparution devant le tribunal
Plaidoyer d’Olympe de Gouges,
rédigé avant sa comparution devant le Tribunal révolutionnaire
3° procès-verbal de séance du tribunal criminel révolutionnaire cliquez
(accéder au fichier pdf)
I - Déroulement du procès
Le 12 brumaire (2 novembre), une « femme de lettres » d’une vie un peu accidentée, Marie-Olympe de Gouges, âgée de trente-huit ans (ou mieux de quarante-cinq), veuve de Jean-Louis Aubry.
C’était une femme de beaucoup d’imagination et de peu de conduite. Elle avait débuté par de petites comédies, des drames, des pièces épisodiques : « Molière chez Ninon ». Elle eût voulu être une nouvelle Ninon. Quand la Révolution éclata, elle s’y tourna tout entière. Elle intervenait dans les mouvements séditieux. Elle avait écrit le 18 juin, l’an IV de la liberté (1792), à Pétion, pour qu’il empêchât la marche du faubourg Saint-Antoine vers les Tuileries (le 20 juin) : car c’était un coup monté. Elle écrivait au roi et à la reine, même après le 10 août, quand ils n’étaient plus guère en mesure de l’entendre ni de la satisfaire : à la reine, pour qu’elle s’interposât auprès de son frère, en faveur de la paix ; au roi, pour qu’il l’autorisât à aller elle-même auprès de ses frères, en son nom, pour arrêter la guerre.
Elle avait fondé des sociétés populaires de femmes. Elle prétendait rivaliser à la tribune avec les plus grands orateurs. Elle voulait parler au peuple aussi et sur tout sujet : la mort du roi, le tribunal révolutionnaire, les Girondins. Ses écrits se placardaient sur tous les murs.
C’est ce qui la perdit.
Après la révolution du 31 mai, quand les départements menaçaient de s’insurger contre Paris, elle eut l’idée de taire une sorte d’appel à la nation et composa un écrit intitulé : Les trois urnes ou le salut de la patrie. Elle y proposait de réunir les assemblées primaires pour délibérer sur la forme de gouvernement à établir : monarchie, république une ou république fédérative.
Avant que son factum fût affiché, on l’arrêta.
Interrogée immédiatement par les administrateurs de police (20 juillet), elle le fut ensuite par Ardouin, juge au tribunal révolutionnaire, et c’est ici que l’on trouve ses explications sur cette affaire.
Dans son placard elle gardait l’anonyme : « Par un voyageur aérien » - « Je me nomme Toxicodendronn ». Elle en reconnut le manuscrit qui avait été saisi chez la citoyenne Longuet, femme de l’imprimeur. Elle dit que le placard avait été tiré à cinq cents exemplaires. Si elle n’y avait pas mis son nom, c’était par modestie, et elle ne sait pas pourquoi l’imprimeur ne s’y est pas nommé. Elle avait songé à en faire hommage au Comité de salut public ; elle l’avait adressé à Hérault-Séchelles, au ministre de l’intérieur : elle les consultait sur son oeuvre, et elle attendait leur réponse, résolue à ne pas l’afficher sans avoir reçu l’avis qu’ils trouvaient le projet utile et opportun, quand elle fut arrêtée sur la dénonciation de l’afficheuse à laquelle elle s’était adressée.
Point de réponse du ministre, ni d’Hérault ; point de soupçon contre eux non plus : elle leur avait écrit pour leur faire connaître son arrestation. Pour la justification de cette affiche même, elle ajoutait qu’elle en avait fait le projet avant que la Constitution fût achevée, et que depuis, les départements s’étant soulevés, elle y avait vu un moyen de prévenir la guerre civile.
Ces explications, elle n’en doutait pas, devaient désarmer ses juge. Dans une lettre (sans date) elle demandait qu’on la mît en liberté sous caution. Sur l’avis du médecin que sa santé demandait des ménagements, on la fit passer de l’Abbaye à la Petite-Force (21 août). Le 30 août, elle s’impatiente : elle écrit au tribunal pour solliciter sa mise en liberté ou son jugement. Mais elle ne s’adresse pas seulement à ses juges. C’est au peuple qu’elle veut parler ; et dans cette lettre qu’elle voulait afficher (et qui existe au dossier en placard), elle ose encore s’attaquer à Robespierre :
Quel est, disait-elle, le mobile qui a dirigé les hommes qui m’ont impliquée dans une affaire criminelle ? La haine et l’imposture.
Robespierre m’a toujours paru un ambitieux sans génie, sans âme : je l’ai toujours vu prêt à sacrifier la nation entière pour parvenir à la dictature. Je n’ai pu supporter cette ambition folle et sanguinaire, et je l’ai poursuivi, comme j’ai poursuivi les tyrans.
Les lois républicaines nous promettaient qu’aucune autorité illégale ne frapperait les citoyens ; cependant un acte arbitraire, tel que les inquisiteurs mêmes de l’ancien régime auraient rougi d’exercer sur les productions de l’esprit humain, vient de me ravir ma liberté au milieu d’un peuple libre.
Et elle refait pour le public l’histoire de son placard et de son arrestation, comme elle l’avait présentée dans son interrogatoire à son juge.
Elle n’eut de nouvelles du tribunal que trois mois plus tard pour comparaître devant lui.
L’acte d’accusation lui reprochait d’avoir fait imprimer « Les trois urnes ou le salut de la patrie », dont nous avons parlé ; il lui reprochait en outre d’avoir écrit une pièce : « La France sauvée ou le tyran détrôné » où elle mettait « dans la bouche du monstre qui dépassa les Messaline et les Médicis » ces expressions impies : « Les faiseurs d’affiches, ces barbouilleurs de papiers, ne valent pas un Marat, un Robespierre ; sous le spécieux langage du patriotisme, ils renversent tout au nom du peuple, ils servent en apparence la propagande, et jamais chefs de faction n’ont mieux servi la cause des rois » etc.
On l’accusait en outre d’être l’auteur de deux placards : l’un, Olympe de Gouges, défenseur de Louis Capet, composé à l’époque du procès du roi ; l’autre, Olympe de Gouges au tribunal révolutionnaire, dont on ne dit ni la date ni l’occasion.
On entendit trois témoins et le Bulletin n’en cite qu’un seul : c’est l’afficheur qui dit qu’invité à placarder Les trois urnes, il s’y était refusé, ayant vu ce que c’était. Était-ce un témoin à charge ou à décharge ? Il donnait, il est vrai, son opinion sur le placard, mais il constatait en même temps qu’il était resté sans publicité. Olympe de Gouges répète ici qu’elle l’avait composé au mois de mai, voyant l’agitation qui se manifestait à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, dans l’espoir qu’en laissant à chacun de se prononcer sur le gouvernement à établir elle pourrait réunir tous les partis et prévenir la guerre civile. Elle affirmait qu’elle était pour le gouvernement républicain, et que depuis longtemps elle professait ces principes, comme les jurés le pourraient voir dans son ouvrage : De l’esclavage des noirs. Quant à la pièce du Tyran détrôné, elle disait que, faisant parler la « femme Capet », elle ne pouvait lui mettre dans la bouche le langage d’un sans-culotte.
Elle ajouta pour sa défense « qu’elle s’était ruinée pour propager les principes de la Révolution, qu’elle était la fondatrice des sociétés populaires de son sexe » etc.
Vaine défense ! Elle fut condamnée surces deux questions (12 brumaire) :
- Existe-t-il au procès des écrits tendant à l’établissement d’un pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple ?
- Olympe Gouges, se disant veuve Aubry, est-elle convaincue d’être l’auteur de ces écrits ?
Condamnée, elle s’écria : « Mes ennemis n’auront point la gloire de voir couler mon sang. Je suis enceinte et donnerai à la République un citoyen ou une citoyenne. »
Les médecins chargés de l’examiner déclarèrent que, vu l’époque récente à laquelle elle prétendait faire remonter sa grossesse, « ils ne pouvaient porter un jugement positif’ de son état »; mais Fouquier-Tinville, se fondant sur ce qu’elle était emprisonnée depuis cinq mois et que, « d’après les règlements concernant lesdites maisons d’arrêt, il ne doit exister aucune communication à l’intérieur et à l’extérieur entre les hommes et les femmes détenus, » conclut à ce qu’il fût « procédé et passé outre dans les vingt-quatre heures à son exécution ».
Ce qui fut fait le même jour (13 brumaire, 3 octobre 1793). En montant à l’échafaud, elle s’écria : « Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort » ; et les spectateurs, agitant leurs chapeaux, lui répondirent par le cri : « Vive la République ! »
Peu de temps avant. son arrestation, quand elle était loin de prévoir sa mort, presque au lendemain de la Révolution du 31 mai, elle avait publié son testament politique. Elle y proteste contre le système de proscription qui vient de prévaloir, et prend encore la défense des Girondins. Elle allègue les sacrifices qu’elle a faits pour la cause populaire. Elle avait cinquante mille livres placées et trente mille livres de mobilier ; il ne lui reste plus que quinze ou seize mille livres, diminution qu’elle imputait aussi à ses charités pendant le grand hiver. Mais son principal héritage, c’est ce qu’elle va léguer avec un certain apparat :
Je lègue mon cœur à la patrie, ma probité aux hommes (ils en ont besoin), mon âme aux femmes, je ne leur fais pas un don indifférent ; mon génie créateur aux auteurs dramatiques : il ne leur sera pas inutile ; surtout ma logique théâtrale au fameux Chesnier ; mon désintéressement aux ambitieux ; ma philosophie aux persécutés ; mon esprit aux fanatiques ; ma religion aux athées ; ma gaieté franche aux femmes sur le retour, et tous les pauvres débris qui me restent d’une fortune honnête à mon héritier naturel, à mon fils, s’il me survit.
Quant à mes pièces de théâtre ou manuscrits, on en trouvera quelques centaines, je les donne à la Comédie-Française, si, par son art magique et sublime, elle croit, après ma mort, mes productions dignes de figurer sur son théâtre : c’est assez lui prouver que je rends justice à son talent inimitable....
Français, voici mes dernières paroles, écoutez-moi dans cet écrit et descendez dans le fond de votre cœur : y reconnaissez-vous les vertus sévères et le désintéressement des républicains ? Répondez : qui de vous ou de moi chérit et sert le mieux la patrie ? Vous êtes presque tous de mauvaise foi. Vous ne voulez ni la liberté ni la parfaite égalité. L’ambition vous dévore... Peuple aimable devenu trop vieux, ton règne est passé, si tu ne t’arrêtes sur le bord de l’abîme ...
Et elle laisse à Danton le soin de défendre ses principes (4 juin 1793).
Danton pouvait ne pas accepter ce legs : mais ce qui fait peine, c’est de voir la malheureuse reniée, après sa mort, par cet héritier naturel qu’elle avait nommé dans son testament. On lit dans le compte rendu de la séance du 24 brumaire (Moniteur du 26) :
Un secrétaire fait lecture d’une lettre d’Aubry, officier dans les armées de la République, fils d’Olympe de Gouges, condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire. Il envoie sa profession de foi sur cette femme. Il se plaint d’avoir été destitué par cela seul qu’elle lui avait donné le jour. Cependant il est loin de partager les opinions inciviques de sa mère ; et les preuves multipliées de son civisme, son sang versé en plusieurs circonstances, en sont la preuve. Il proteste de son dévouement à la République.
Merlin de Thionville demanda le renvoi de sa lettre au ministre de la guerre, afin de le rendre à ses fonctions, si la condamnation de sa mère l’avait seule fait destituer. C’était juste : mais cette lettre est un titre bien peu honorable à sa rentrée sous les drapeaux.*
Plaidoyer d’Olympe de Gouges, rédigé avant sa comparution devant le Tribunal révolutionnaire.
TRIBUNAL redoutable, devant lequel frémit le crime et l’innocence même, j’invoque ta rigueur,si je suis coupable ; mais écoute la vérité :
L’ignorance et la mauvaise foi sont enfin parvenues à me traduire devant toi : je ne cherchais pas cet éclat. Contente d’avoir servi; dans l’obscurité, la cause du peuple, j’attendais avec modestie et fierté une couronne distinguée que la postérité seule peut donner, à juste titre, à ceux qui ont bien mérité de la patrie. Pour obtenir cette couronne éclatante, il me fallait sans doute être en butte à la plus noire des persécutions ; il fallait encore plus : il me fallait combattre la calomnie, l’envie, et triompher de l’ingratitude. Une conscience pure et imperturbable, voilà mon défenseur.
Pâlissez ,vils délateurs ; votre règne passe comme celui des Tyrans. Apôtres de l’anarchie et des massacres, je vous ai dénoncés depuis longtemps à l’humanité : voilà ce que vous n’avez pu me pardonner.
Vieux esclaves des préjugés de l’ancien régime, valets gagés de la cour, républicains de quatre jours, il vous sied bien d’inculper une femme née avec un grand caractère et une âme vraiment républicaine ; vous me forcez à tirer vanité de ces avantages, dons précieux de la nature, de ma vie privée et de mes travaux patriotiques.
Les taches que vous avez imprimées à la nation française ne peuvent être lavées que par votre sang que la loi fera bientôt couler sur l’échafaud. En me précipitant dans les cachots, vous avez prétendu vous défaire d’une surveillante, nuisible à vos complots. Frémissez, Tyrans modernes ! ma voix se fera entendre du fond de mon sépulcre. Mon audace vous met à pis faire ; c’est avec le courage et les armes de la probité que je vous demande compte de la tyrannie que vous exercez sur les vrais soutiens de la patrie.
Et vous, Magistrats qui allez me juger apprenez à me connaître ! Ennemie de l’intrigue, loin des systèmes, des partis qui ont divisé la France au milieu du choc des passions, je me suis frayé une route nouvelle ; je n’ai vu que d’après mes yeux ; je n’ai servi mon pays que d’après mon âme ; j’ai bravé les sots, j’ai frondé les méchants et j’ai sacrifié ma fortune entière à là révolution.
Quel est le mobile qui a dirigé les hommes qui m’ont impliquée dans une affaire criminelle ? La haine et l’imposture.
Robespierre m’a toujours paru un ambitieux, sans génie, sans âme. Je l’ai vu toujours prêt a sacrifier la nation entière pour parvenir à la dictature ; je n’ai pu supporter cette ambition folle et sanguinaire, et je l’ai poursuivi comme j’ai poursuivi les tyrans. La haine de ce lâche ennemi s’est cachée longtemps sous la cendre, et depuis, lui et ses adhérents attendaient avec avidité le moment favorable de me sacrifier à sa vengeance.
Les Français, sans doute, n’ont pas oublié ce que j’ai fait de grand et d’utile pour la patrie ; j’ai vu depuis longtemps le péril imminent qui la menace, et j’ai voulu par un nouvel effort la servir. Le projet des trois urnes développé dans un placard, m’a paru le seul moyen de la sauver, et ce projet est le prétexte de ma détention.
Les lois républicaines nous promettaient qu’aucune autorité illégale ne frapperait les citoyens ; cependant un acte arbitraire, tel que les inquisiteurs, même de l’ancien régime, auraient rougi d’exercer sur les productions de l’esprit humain, vient de me ravir ma liberté, au milieu d’un peuple libre.
À l’art 7 de la Constitution, la liberté des opinions et de la presse n’est-elle pas consacrée comme le plus précieux patrimoine de l’homme ? Ces droits, ce patrimoine, la Constitution même, ne seraient-ils que des phrases vagues, et ne présenteraient-ils que des sens illusoires ? hélas ! j’en fais la triste expérience ; républicains, écoutez-moi jusqu’au bout, avec attention.
Depuis un mois, je suis aux fers ; j’étais déjà jugée, avant d’être envoyée au Tribunal révolutionnaire par le sanhédrin de Robespierre, qui avait décidé que dans huit jours je serais guillotinée. Mon innocence, mon énergie, et l’atrocité de ma détention ont fait faire sans doute à ce conciliabule de sang, de nouvelles réflexions ; il a senti qu’il n’était pas aisé d’inculper un être tel que moi, et qu’il lui serait difficile de se laver d’un semblable attentat ; il a trouvé plus naturel de me faire passer pour folle. Folle ou raisonnable, je n’ai jamais cessé de faire le bien de mon pays ; vous n’effacerez jamais ce bien et malgré vous, votre tyrannie même le transmettra en caractères ineffaçables chez les peuples les plus reculés ; mais ce sont vos actes arbitraires et vos cyniques atrocités qu’il faut dénoncer à humanité et à la postérité. Votre modification à mon arrêt de mort me produira un jour un sujet de drame bien intéressant ; mais je continue de te poursuivre caverne infernale ; où les furies vomissent à grands flots le poison de la discorde que ces énergumènes vont semer dans toute la république, et produire la dissolution entière de la France, si les vrais républicains ne se rallient pas autour de la statue de la liberté. Rome aux fers n’eût qu’un Néron, et la Francs libre en a cent.
Citoyens, ouvrez les yeux, il est temps, et ne perdez pas de vue ce qui suit :
J’apporte moi-même mon placard chez l’afficheur de la commune qui en demanda la lecture ; sa femme, que je comparais dans ce moment à la servante de Molière, souriait et faisait des signes d’approbation pendant le cours de cette lecture ; il est bon, dit-elle, je l’afficherai demain matin.
Quelle fut ma surprise le lendemain ? je ne vis pas mon affiche ; je fus chez cette femme lui demander le motif de ce contretemps. Son ton et sa réponse grotesques m’étonnèrent bien davantage : elle me dit que je l’avais trompée, et que mon affiche gazouillait bien différemment hier qu’elle ne gazouille aujourd’hui.
C’est ainsi, me disais-je, que les méchants, parviennent à corrompre le jugement sain de la nature ; mais, ne désirant que le bien de mon pays, je me portai à dire à cette femme que je ferais un autodafé de mon affiche, si quelque personne capable d’en juger, lui eût dit qu’elle pouvait nuire a la chose publique. Cet évènement m’ayant fait faire quelques réflexions sur la circonstance heureuse qui paraissait ramener les départements m’empêcha de publier cette affiche. Je la fis passer au comité de salut public, et je lui demandai son avis, que j’attendais sa réponse pour en disposer.
Deux jours après je me vis arrêtée et traînée à la mairie, où je trouvais le sage, le républicain, l’impassible magistrat Marino. Toutes ces rares qualités, vertus indispensables de l’homme en place, disparurent à mon aspect. Je ne vis plus qu’un lion rugissant, un tigre déchaîné, un forcené sur lequel un raisonnement philosophique n’avait fait qu’irriter les passions ; après voir attendu 3 heures en public son arrêt, il dit en inquisiteur à ses sbires : conduisez madame au secret, et que personne au monde ne puisse lui parler.
La veille de mon arrestation j’avais fait une chute, je m’étais blessée à la jambe gauche ; j’avais la fièvre et mon indignation ne contribua pas peu à me rendre la plus infortunée des victimes. Je fus renfermée dams une mansarde de 6 pieds de long, sur 4 de large, où se trouvait placé un lit ; un gendarme qui me quittait pas d’une minute jour et suit, indécence dont la bastille et les cachots de l’inquisition n’offrent point d’exemples. Ces excès sont une preuve que l’esprit public est tout à fait dégénéré et que les Français touchent au moment de leur fin cruelle, si la Convention n’expulse pas ces hommes qui renversent les décrets et paralysent entièrement la loi.
Je n’ai cependant qu’à me louer de l’honnêteté et du respect des Gendarmes ; j’ajouterai même que ma douloureuse situation leur arracha plus d’une fois des larmes. La fièvre que j’avais toutes les nuits, un amas qui se formait dans ma jambe, tout appelait vers moi, quand même j’aurais été criminelle, les secours bienfaisants de la sainte humanité. Ah ! Français, je ne peux me rappeler ce traitement sans verser des larmes. Vous aurez de la peine à croire que des hommes, des magistrats ,soi-disant populaires, aient poussé la férocité jusqu’à me refuser pendant sept jours de faire appeler un médecin et de me faire apporter du linge. Vingt fois la même chemise que j’avais trempée de mes sueurs se resécha sur mon corps. Une cuisinière du maire de Paris, touchée de mon état, vint m’apporter une de ses chemises Son bienfait fut découvert et j’appris que cette pauvre fille avait reçu les reproches les plus amers de son humanité.
Quelques honnêtes administrateurs furent si indignés de ce traitement qu’ils déterminèrent l’époque de mes interrogatoires Il est aisé de reconnaître dans ces incroyables interrogatoires la mauvaise foi et la partialité du juge qui m’interrogeait : « Vous n’aimez pas les Jacobins, me dit-il, et ils n’ont pas le droit de vous aimer non plus ! ». « J’aime, Monsieur, lui répondis-je avec la fierté de l’innocence, les bons citoyens qui composent cette société mais je n’en aime pas les intrigants. »
Il fallait, je le savais d’avance, flatter ces tigres, qui ne méritent pas de porter le nom d’hommes, pour être absous ; mais celui qui n’a rien à se reprocher, n’a rien à craindre. Je les défiais ; ils me menacèrent du tribunal révolutionnaire. C’est là où je vous attends, leur dis-je. Il fallut mettre les scellés sur mes papiers. Le neuvième jour, je fus conduite chez moi par cinq Commissaires. Chaque papier qui tombait entre leurs mains était de nouvelles preuves de mon patriotisme et de mon amour pour la plus belle de toutes les causes. Ces Commissaires, mal prévenus d’abord, et surpris de trouver tout à ma décharge, n’eurent point le courage d’apposer les scellés ; ils ne purent s’empêcher de convenir, dans leur procès-verbal, que tous mes papiers manuscrits et imprimés ne respiraient que patriotisme et républicanisme. Il fallait me délivrer.
C’est ici que mes juges s’embarrassent ; revenir sur leurs pas, réparer une grande injustice en me priant d’oublier cet odieux traitement, un tel procédé n’est pas fait pour des âmes abjectes ; ils trouvèrent plus agréable de me transférer à l’abbaye, où je suis depuis trois semaines, placée dans une de ces chambres où l’on voit le sang des victimes du 2 septembre imprimé sur les murs. Quel spectacle douloureux pour ma sensibilité ; en vain je détourne mes yeux, mon âme est déchirée ; je péris à chaque minute du jour sans terminer ma déplorable vie.
Ce récit fidèle, bien au-dessous du traitement odieux que j’ai reçu, va fixer le Tribunal révolutionnaire sur ma cause, et mettre fin à mes tourments. Quelle sera sa surprise, et celle de la masse entière des Français, quand ils apprendront, malheureusement trop tard, que mon projet des Trois Urnes pouvait sauver la France du joug honteux dont elle est menacée ; quand enfin, par une de ces grandes mesures que la providence inspire aux belles âmes, je réveillais l’honneur de la nation, et je la forçais à se lever toute entière pour détruire les rebelles et repousser l’étranger. Cette affiche et mon mémoire qui ne peut se placarder par l’étendue de la matière vont, par le moyen de la distribution à la main, éclairer le public ; oui, mes concitoyens, ce comble d’indignité va servir mon pays. A ce prix, je ne me plains plus : et je rends grâce à la malveillance de m’avoir fourni encore cette occasion.
Et toi, mon fils, de qui j’ignore la destinée, viens en vrai Républicain te joindre à une mère qui t’honore, frémis du traitement inique qu’on lui fait éprouver ; crains que mes ennemis ne fassent rejaillir sur toi les effets de leurs calomnies. On voit dans le journal de l’Observateur de l’Europe, où l’Écho de la liberté, à la feuille du 3 août, une lettre d’un dénonciateur gagé, datée de Tours, qui dit : « Nous avons ici le fils d’Olympe de Gouges pour général. C’est un ancien serviteur du château de Versailles ». Il est facile de démentir un mensonge aussi grossier ; mais les machinateurs ne cherchent pas à prouver ; il leur suffit seulement de jeter de la défaveur sur la réputation d’un bon militaire. Si tu n’es pas tombé sous les coups de l’ennemi, si le sort te conserve pour essuyer mes larmes, abandonne ton rang à ceux qui n’ont d’autre talent que le calcul, que de déplacer-les hommes utiles à la chose publique ; viens en vrai Républicain demander la loi du Talion conte les persécuteurs de ta mère.
Signé : OLIMPE DE GOUGES
08:56 Publié dans La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : olympe de gouges | ![]() Facebook |
Facebook |  | |
| |  |
|  Imprimer | |
Imprimer | |












Commentaires
patrick
n oublie pas le premier proces politique de notre histoire
le 12 decembre 1792
Écrit par : mise a jour | 23/11/2007
Répondre à ce commentaireGrand article mon ami, j'ai vraiment apprécié la lecture de votre post.
Écrit par : Bea from greece | 18/07/2011
Répondre à ce commentaireLes commentaires sont fermés.